Cet article est extrait du n°11 de la revue Y, téléchargeable ici.
Début d’après-midi, à environ un mile au nord de Camden Town. Un crachin insupportable s’abat sur la capitale. On avance vers l’inconnu, ou plutôt vers un squat inconnu, où habitent deux potes français que nous appellerons Joshua et Timothy. Les numéros des portes défilent et on se rapproche peu à peu de l’adresse qu’ils nous ont donnée. Le crachin se calme. La rue paraît interminable tandis que grandit notre excitation.
Arrivés au fameux numéro, le doute nous envahit… rien. Rien, à part un vieux pub abandonné entre une maison pas franchement rassurante et une sorte de garage protégé par une grille cadenassée. On espère s’être trompé de rue mais non. On scrute le pub, magnifique bâtiment à la façade en bois peinte et un peu défraîchie qui rend l’ensemble encore plus charmant. À l’intérieur, pas de surprise : les vitres opaques et sales ne laissent entrevoir qu’un comptoir et quelques chaises poussiéreuses. Une sorte d’avis de la mairie placardé sur l’une des vitres du pub ne nous laisse plus aucun doute, c’est bien là qu’on doit aller. Un petit coup de fil à Joshua et il descend aussitôt nous accueillir dans une minuscule allée bordant le pub et obstruée par un vieux camion. « Bordel mec, tu vis dans un pub ?! »
La visite commence, mais le pub n’est que la face cachée de l’iceberg. « On a tout le bâtiment », me dit Joshua, « c’est un pub mythique, Nirvana a joué là, et c’est même là qu’un énorme groupe anglais a signé son putain de deal… ». On monte au premier étage, pour arriver dans une sorte de salon immense, avec des moulures d’époque au plafond. Un autre mec est là avec sa fille, qui doit sûrement avoir entre 8 et 10 ans. Je les vois jouer sur le toit du pub, qui donne sur la rue. La première salle de bain adjacente est une vraie merveille. Gigantesque, avec un jacuzzi, une douche, un carrelage blanc immaculé. Sûrement la salle de bain du proprio de l’époque. Le stéréotype du squat pourri rempli d’héroïnomanes que j’avais, bien ancré au fond de ma tête, change alors complètement… Les mecs ont un bâtiment pour eux tous seuls, dans Londres, au pied d’une bouche du métro ; Un endroit beau et propre, bien tenu, avec l’électricité, l’eau, le chauffage, Internet… J’essaie d’estimer la surface mais c’est impossible, trop de portes fermées et de couloirs. Peut être 300 mètres carrés. J’ai cruellement besoin d’explications.
« Ce qu’on fait est entièrement légal, et en plus, on est payé pour le faire ! » m’explique Joshua. Les bras m’en tombent.
Il m’explique en gros qu’après être passés par de nombreux squats un peu plus douteux (dont un où deux mafieux de l’Essex les avaient menacés de mort et de dépecer leur chien vivant), ils sont tombés sur ce bâtiment, dont le proprio les paye pour veiller sur le lieu avant de le revendre. « On a tellement pris soin des endroits où on vivait qu’on est devenus des caretakers… » Comprenez des gardiens. « On est même plus des vrais squatteurs. »
« Le truc c’est d’aller trouver sur Internet qui est le propriétaire du bâtiment. Si c’est une compagnie de taxi de l’Essex, tu peux être sûr que la mafia va débarquer dans la semaine pour te foutre dehors. On a trouvé ce squat et on l’a remis à neuf pour y vivre. En voyant à quel point on était réglo, des gens nous ont proposé de nous payer pour rester et faire gaffe à l’immeuble. Et éviter aussi que la piaule soit reprise par des toxicos qui foutent tout en l’air avant de se casser. » Bref, en échange d’un relevé de compteur hebdomadaire et d’un minimum de rigueur, ils peuvent occuper un bâtiment. « Voilà », dit Timothy en rigolant, « c’est devenu notre métier, on est des sortes de gardiens. » Le concept devient en moins en moins flou, d’autant qu’il est extrêmement avantageux pour les propriétaires qui, si leur local commercial reste vide, payent une sorte de taxe de 2 000 livres par mois, tout en risquant de voir leur bien occupé par des squatteurs pas très respectueux… Alors pour y remédier, ils font appel à des sociétés de gardiennage, qui elles-mêmes recrutent des squatteurs professionnels pour servir d’alarmes vivantes.
Nous partons prendre un peu l’air pour aller relever les compteurs d’un autre pub dont ils doivent s’occuper, à deux pas du Koko. Sur le chemin, on évoque les différents moyens pour ouvrir un bâtiment, comment ne laisser aucune trace d’effraction, déceler les entrées potentielles. On arrive devant l’immeuble. Ici encore, un établissement qui a fait faillite. Le décor est apocalyptique. Des pintes à moitié pleines jonchent le bar, des courriers à peine ouverts forment une véritable montagne dans un coin du comptoir. On monte faire le relevé du compteur pour le propriétaire, sauf qu’ici le ménage n’a pas été fait par mes potes. « Peine perdue. Mais on va peut être nous payer pour nettoyer. Si c’est le cas, on le fera… », me dit Timothy. La faible luminosité ne permet pas de distinguer un escalier d’un mur, les trous dans le parquet rendent le parcours périlleux, l’odeur est insoutenable. Pourtant, le lieu, empreint d’histoire, me passionne, je le trouve magnifique et enrage que le manque de lumière m’empêche de prendre quelques photos correctes.
On remplit notre mission et on quitte aussitôt ce qui fut jadis un endroit plein de vie, aujourd’hui devenu un champ de ruines. Pas la peine pour les deux acolytes de résider au pub, le bâtiment dispose d’alarmes reliées à la société de sécurité qui les emploie et les prévient directement. « Il y a pas longtemps, l’alarme a sonné », dit Joshua. « On s’attendait à devoir déloger quelque chose de pas franchement agréable, mais on s’est rendu compte que c’était une meuf qu’on connaissait qui avait essayé de récupérer le pub ».
On retrouve l’air libre, le soleil ne va plus tarder à se coucher. La soirée du lendemain se passe au premier pub, « le château » comme je l’appelle. On mate un film avec quelques bières dans la chambre de Joshua, depuis un gros Mac et son home cinema. Ici pas de problèmes de voisins : les 5 colocataires partagent 3 étages, alors que l’immeuble pourrait accueillir au moins une trentaine de squatteurs…
Quelques heures plus tard, en rentrant, je me demande si cette vie est désirable, si elle peut représenter une vraie alternative à la jungle immobilière londonienne pour une poignée d’opportunistes.
Je repense alors au moment où, en allant acheter à boire avec Joshua, on a croisé un punk à chien assez dégueu, debout comme ça en pleine rue, immobile. Ils se sont reconnus, se sont dit bonjour. Le type a débité péniblement quelques mots, il avait l’air raide à quelque chose que j’aimerais franchement pas tester. On a continué notre route. « Le mec là, je le connais, il a voulu me prendre ma sono une fois. Il va essayer d’ouvrir le bâtiment là, juste en face, il attend le reste de sa bande ». Le bâtiment en question est une sorte de hangar géant aux allures d’église, d’immenses plaques de métal barricadent les fenêtres. Au dessus, des carreaux cassés. Joshua les regarde. « Tu vois là, les carreaux éclatés. Jamais j’essaierai d’ouvrir cet endroit, il fait trop froid pour vivre là-dedans, et ça doit être crade ». Mais ce pauvre toxico, dont on s’est éloignés peu à peu, n’a peut-être pas le choix.
Et je repense à la question que je me posais tout à l’heure : cette vie là vaut-elle le coup ? Je ne trouve toujours aucune réponse.

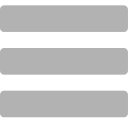


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.